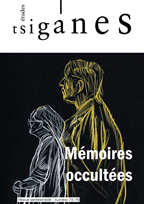|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
n° 75-76 - Mémoire occultées Si l’histoire des Tsiganes a principalement été construite à partir des instruments de contrôle qui ont pesé sur leur destin, ce sont aujourd’hui les enjeux mémoriels qui émergent dans la sphère publique, principalement à partir des lieux d’internement et de déportation des nomades durant la Seconde Guerre mondiale. En résonance avec ce contexte, nous avons souhaité, à travers ce numéro, interroger les mémoires occultées qui ont contribué à forger l’inscription des groupes tsiganes et voyageurs dans les territoires où ils vivent depuis des décennies ou même des siècles. Assujettis à de multiples déplacements, marginalisés et déclassés, ils sont pourtant porteurs d’une mémoire susceptible d’éclairer l’histoire locale. Des Abattoirs de Montpellier aux Kaskarots du Pays basque, en passant par les petits métiers qu’ils exerçaient ou par l’exploration de fonds d’archives photographiques, les articles de ce numéro interrogent une historicité souvent complexe et passionnante dont la mise à jour relève d’un véritable enjeu de reconnaissance. Dévoiler les mémoires occultées, dont les trajectoires de ces familles sont porteuses, est aussi une manière de lutter contre l’extranéité et l’extraction systémiques de ces populations de nos imaginaires et récits collectifs.
|
||||||
n° 74 - La
fête De la fête foraine au mariage gitan, la fête fait partie intégrante des modalités d’expression et de perception des populations tsiganes. Attractive, sensationnelle ou dérangeante, elle ne laisse pas indifférents les observateurs extérieurs au point de devenir dans certains cas le prétexte à une mise en scène des identités tsiganes. La vivacité des approches esthétiques et artistiques inspirées de l’imaginaire de la fête tsigane se décline aussi bien à travers des représentations essentialistes, genrées et racisées, tout comme elle peut se muer en instrument subversif de ces identités à travers des figures androgynes ou travesties.
|
||||||
n° 72-73 - Ukraine L’offensive russe sur l’Ukraine est au cœur de l’actualité mondiale depuis le 24 février 2022. Le surgissement de la guerre, comme souvent, ravive ou met en péril les possibilités d’affirmation des minorités culturelles. Or, l’Ukraine fait partie des pays européens où l'implantation des Roms est historiquement et culturellement importante. L'offensive russe a rendu terrible la vie de nombreuses personnes en Ukraine et les Roms ne font pas exception. Certains d'entre eux combattent dans l'armée ukrainienne, d'autres vivent sous occupation russe dans l'est et le sud de l'Ukraine, d'autres ont dû fuir l'Ukraine. Cependant, en tant que réfugiés, les Roms ukrainiens sont souvent mal accueillis en Europe et souffrent de discrimination à bien des égards. Aussi, nous avons souhaité mettre en lumière différents aspects de la participation des Roms à la culture nationale ukrainienne, en proposant dans ce numéro thématique des traductions portant sur des sujets variés en anthropologie, histoire, histoire de l’art, littérature et linguistique permettant de saisir la diversité et la richesse de la contribution culturelle des Roms d’Ukraine.
|
||||||
|
||||||